Dissolution, ultime recours
Au lendemain des élections européennes du 9 juin 2024, Emmanuel Macron surprend le pays en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale. Le chef de l’État justifie ce recours inédit en invoquant la sanction infligée par les électeurs à son camp et la paralysie d’une majorité relative qui depuis 2022 ne dispose que de 250 sièges sur 577. Le premier tour des législatives anticipées le 30 juin 2024 et le second tour une semaine plus tard aboutissent à un Parlement sans majorité. L’alliance de gauche du Nouveau Front populaire obtient environ 182 sièges, la coalition présidentielle 168 et le Rassemblement national 143, laissant l’hémicycle éclaté et le pays au bord de l’impasse. Gabriel Attal, alors premier ministre, remet sa démission mais reste à Matignon pour expédier les affaires courantes en attendant qu’une majorité stable se dégage.
Loin d’apporter l’éclaircie espérée, ce scrutin ouvre une crise gouvernementale durable. L’exécutif tente d’abord un virage à droite en nommant l’ancien commissaire européen Michel Barnier. Faute de majorité, il recourt à l’article 49.3 pour faire adopter un budget d’austérité et tombe au bout de trois mois après un vote de censure. François Bayrou lui succède en décembre 2024 avec la promesse de rétablir les comptes publics et de renouer le dialogue social. Il est à son tour renversé en septembre 2025 par un vote de confiance qu’il avait lui‑même engagé, ouvrant une séquence inédite où la France se retrouve sans premier ministre durable alors que l’inflation, la dette et la réforme des retraites provoquent des tensions sociales.
Emmanuel Macron appelle alors le ministre Sébastien Lecornu à Matignon. Ce dernier forme un gouvernement à 34 membres et annonce une « gouvernance de mission ». Au lendemain de sa nomination, il présente sa démission pour protester contre les pressions exercées par ses partenaires ; il est aussitôt reconduit et dévoile un nouvel exécutif qui mêle centristes et personnalités de gauche. Pour conserver son fragile soutien, il suspend la réforme des retraites adoptée en 2023, renonce à utiliser l’article 49.3 sur le budget et promet de consulter davantage le Parlement. Ces gestes apaisent temporairement le Parti socialiste, qui vote contre la destitution et permet au gouvernement de survivre en octobre 2025 à deux motions de censure, tandis que le RN et La France insoumise réclament des élections. Le gouvernement reste minoritaire et doit négocier chaque texte au cas par cas.
Cette instabilité remet en lumière l’arme constitutionnelle de la dissolution. L’article 12 de la Constitution autorise le président à dissoudre l’Assemblée nationale après consultation du premier ministre et des présidents des deux chambres. Une fois la décision prise, de nouvelles élections doivent se tenir entre vingt et quarante jours plus tard, et aucun nouveau recours à la dissolution n’est possible pendant un an. Après le scrutin de juillet 2024, Emmanuel Macron ne pouvait donc pas dissoudre à nouveau avant le 8 juillet 2025. Au cœur de l’automne, ce délai légal est échu et le chef de l’État retrouve la faculté de renvoyer les députés devant les électeurs.
Les partisans d’une dissolution insistent sur la nécessité d’un arbitrage populaire. Marine Le Pen juge ce retour aux urnes « absolument inévitable » et estime que seule une majorité clairement identifiée peut sortir le pays de l’ornière. La France insoumise dépose une proposition de destitution et boycotte les consultations, considérant que la seule issue est de rendre la parole aux citoyens. Du côté de la droite traditionnelle, des figures comme Bruno Retailleau refusent de « rejouer la loterie » et craignent qu’un nouveau vote amplifie la poussée du RN. Dans les rangs de la majorité, de nombreux députés redoutent une sanction et militent pour des compromis avec le centre gauche afin d’arracher un budget et d’éviter la dissolution.
À l’Élysée, Emmanuel Macron use de la menace comme levier. Lors d’un Conseil des ministres à la mi‑octobre, il lance un avertissement solennel : « une motion de censure est une motion de dissolution ». Le président rappelle que la France traverse une crise politique, mais pas une crise de régime, et en appelle à la responsabilité des parlementaires. Son porte‑parole souligne que les Français sont lassés des querelles et que l’exécutif ne restera pas les bras croisés en cas de blocage. Ce discours, relayé par plusieurs ministres, vise à dissuader l’opposition de faire tomber le gouvernement et à convaincre les alliés hésitants de voter le budget.
Pour autant, la fenêtre de tir se referme rapidement. La Constitution impose que les législatives aient lieu entre vingt et quarante jours après la dissolution et que la nouvelle Assemblée siège le deuxième jeudi suivant l’élection. Or, pour boucler un budget avant la fin de l’année, l’hémicycle doit être en place au plus tard mi‑décembre. Plusieurs constitutionnalistes soulignent qu’à partir de mi‑novembre il sera matériellement impossible d’organiser le scrutin, de faire campagne et de faire siéger les députés avant la fin de l’année. Un recours à l’ordonnance budgétaire serait possible, mais il serait vivement contesté et renforcerait le procès en autoritarisme. L’exécutif pourrait alors patienter jusqu’au printemps 2026, lorsque la période de congés et le calendrier politique se prêteront davantage à une dissolution.
Dans ce contexte, la dissolution apparaît comme l’ultime option. Elle demeure la prérogative exclusive du chef de l’État, mais son usage comporte des risques. Depuis un an, les sondages donnent le Rassemblement national en tête et la gauche divisée. Une nouvelle campagne pourrait offrir à l’extrême droite la possibilité d’accéder à Matignon, voire de décrocher une majorité absolue. Elle pourrait aussi prolonger la paralysie si aucun camp n’emporte plus de sièges qu’en 2024. Beaucoup de députés, y compris parmi les opposants, préfèrent donc la recherche d’un compromis budgétaire, quitte à soutenir un gouvernement minoritaire jusqu’en 2026. Emmanuel Macron, lui, rappelle qu’il ne se laissera pas paralyser par l’immobilisme et qu’en ultime recours il laissera les Français trancher. Entre menace et contrainte, l’hypothèse d’une nouvelle dissolution plane sur la vie politique française comme une épée de Damoclès, sans que personne ne puisse dire si elle remettrait de l’ordre dans le chaos ou si elle l’aggraverait.

Italie: près de 2100 œuvres d'art contrefaites
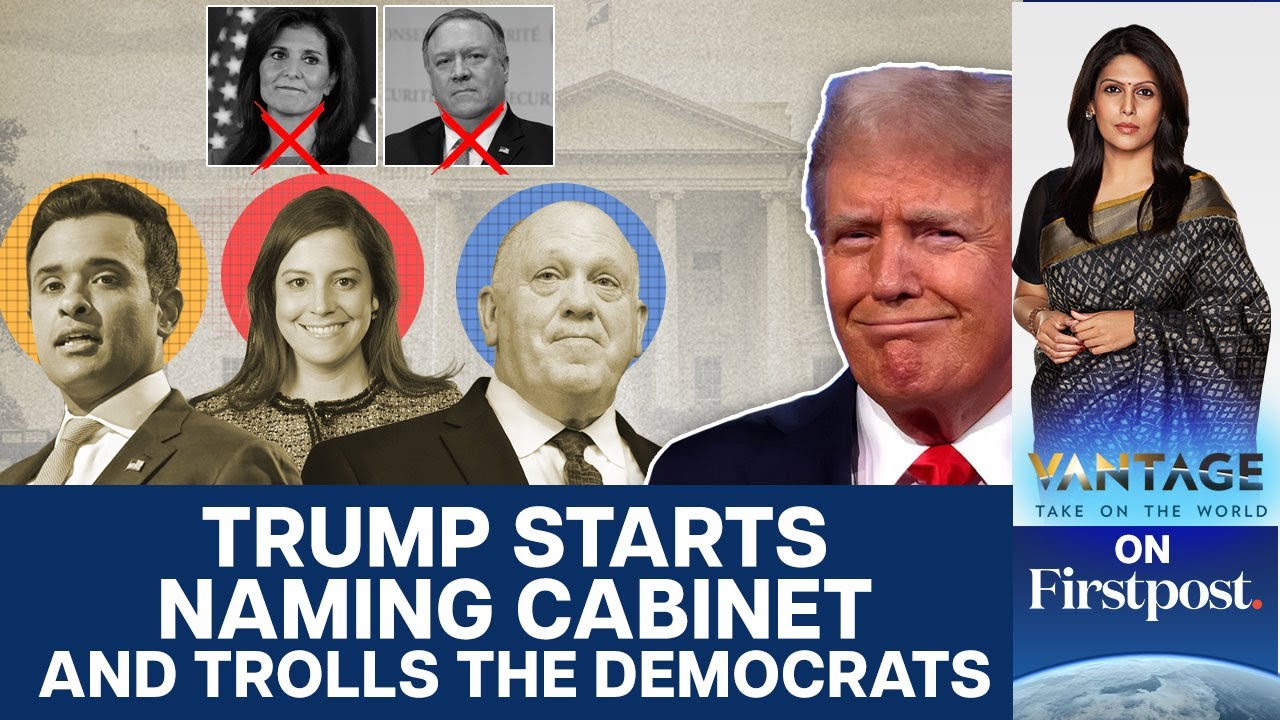
Immigration: Donald Trump rappelle Tom Homan
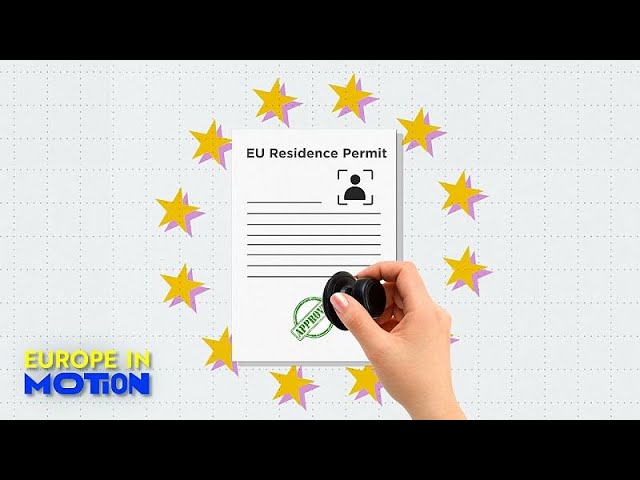
Record des permis de séjour en EU

EU: Comment faire face à Donald Trump?
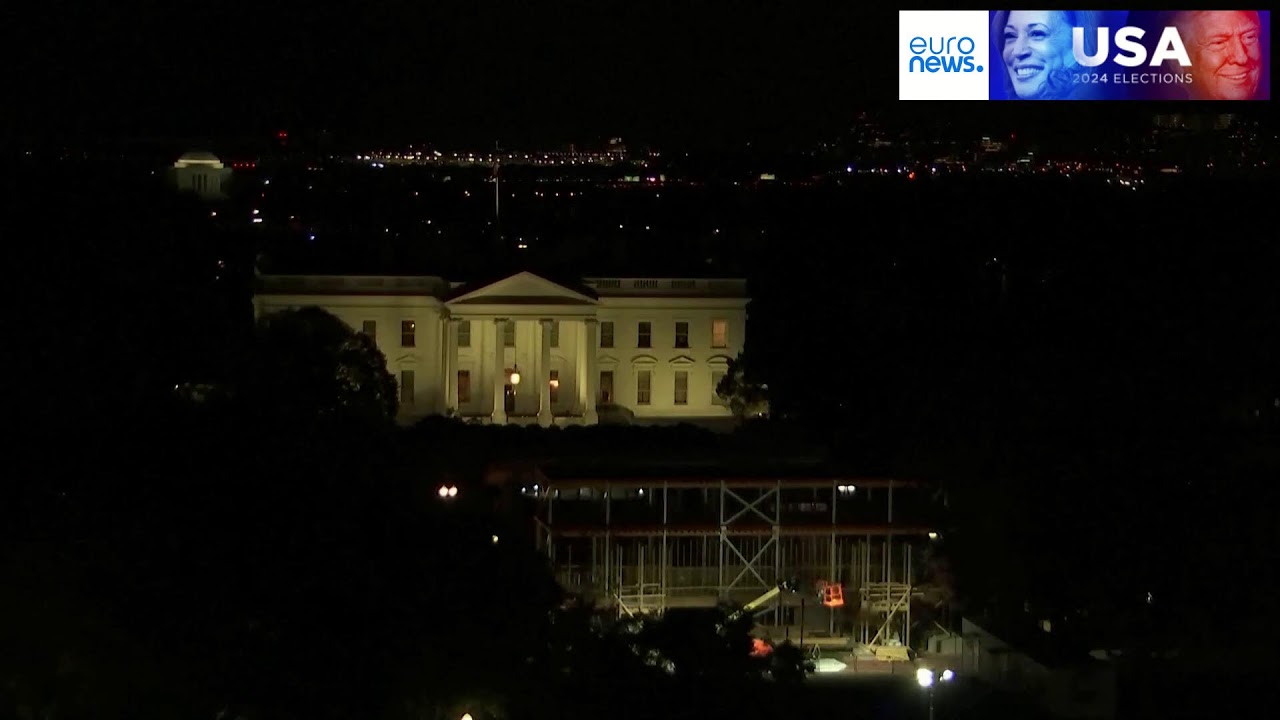
Élection Présidentielle américaine 2024

La Géorgie: Où va-t-on à l'avenir?

L'Algérie et les paiements numériques

L'Algérie et les paiements numériques

UE: Droits de douane punitifs de Donald Trump?
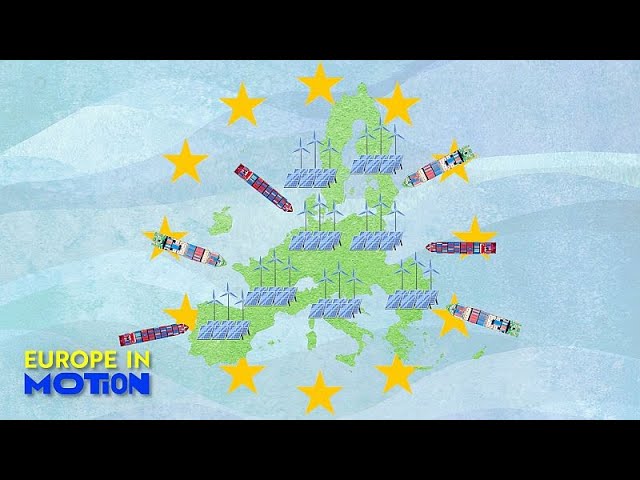
Exportations d'énergie verte de l'UE

Un robot dirige l'orchestre symphonique de Dresde


 Paris
Paris

 Lyon
Lyon
 Lille
Lille
 Monaco
Monaco
 Bordeaux
Bordeaux
 Luxembourg
Luxembourg
 Marseille
Marseille
 Brussels
Brussels
 Guernsey
Guernsey
 Jersey
Jersey
 Burkina Faso
Burkina Faso
 Guinea
Guinea
 Mali
Mali


